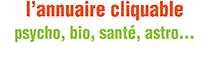Amanda Lear
Une femme peut en cacher une autre…
|

Femme cultivée et amie des plus grands, elle se complaît dans les gaudrioles des “ Grosses têtes ”. Reine de la provocation ayant fait de l’ambiguïté sexuelle son fond de commerce, elle se présente comme la plus fervente partisane des valeurs familiales et religieuses traditionnelles. Amanda Lear aime brouiller les pistes. On imagine sa vie rimer avec la chanson de Régine “ Plumes strass boys ” ; elle nous parle, au contraire, de sa profonde détresse intérieure et des quêtes perpétuelles d’un bonheur qu’elle sait illusoire. Interview de celle que Gérard Miller a décrite comme “ la plus désespérée de nos boute-en-train ”.
Psychanalyse Magazine : Vous êtes née à Hong Kong d’une mère chinoise et d’un père anglais. Pour le reste, vous êtes très discrète sur votre jeunesse…
Amanda Lear : On essaie toujours d’éclairer a posteriori le destin des célébrités par les circonstances de leur enfance. Je ne vois pas l’intérêt d’une telle démarche. Dans mon cas, je ne pense pas en tout cas que cela soit significatif. Ma mère était très religieuse, mon père archi-discipliné car membre de la marine de sa Gracieuse Majesté. Je voyais mes parents mener leur petite vie tranquille et je me disais simplement que, plus tard, il ne serait pas question que je leur emboîte le pas dans cette existence pitoyable.
P. M. : Vous avez donc eu très tôt soif de notoriété ?
A. L. : j’ai toujours su qu’un jour je deviendrais très célèbre. C’était décidé. Mais je ne savais pas de quelle manière. J’aurais pu tout aussi bien devenir la plus grande criminelle de l’Histoire ou faire de la danse. Contrairement à beaucoup d’artistes, je n’ai jamais rien planifié, j’ai toujours agi par instinct. Tout est arrivé par accident, grâce aux rencontres que j’ai faites : Salvador Dali, Andy Warhol, David Bowie… Il y a eu une énorme part de hasard – Freud aurait peut-être parlé de hasard objectif.
P. M. : Une des rencontres déterminantes, c’est bien sûr Dali…
A. L. : Il m’a beaucoup appris, non seulement d’un point de vue artistique – la peinture, l’histoire de l’art… – mais aussi d’une certaine philosophie de la vie qui lui était propre, inattendue et séduisante. Pour être heureux, Dali n’avait pas besoin de boire, de fumer, ni de goûter aux paradis artificiels. Un verre d’eau minérale qu’il dégustait à la manière d’un grand cru était sa meilleure drogue.
P. M. Mannequin à vos débuts, vous avez été ensuite propulsée star du disco dans les années 70. La discothèque “ Le Palace ” a marqué une étape décisive pour vous qui n’étiez connue qu’en Italie…
A. L. : C’est en effet moi qui ai, en septembre 1978, inauguré ce véritable symbole de toute cette époque folle et insouciante. La peinture n’était pas sèche, les loges pas terminées, il y avait 5000 personnes dehors qui faisaient la queue… Je ne savais pas que j’entamais d’un coup ma carrière française mais aussi un chapitre de ma vie. Car ce soir-là, Alain-Philippe Malagnac, mon futur mari, était dans la salle. Il est venu dans ma loge me demander un autographe avec son père adoptif, Roger Peyrefitte et, le lendemain, on déjeunait ensemble. Ce fut le début de notre histoire d’amour.
P. M. : Une relation qui durera 22 ans. Mais votre vie bascule, à Noël 2000, lorsqu’un incendie emporte votre mari et votre maison de Saint-Rémy de Provence. Vous envisagez alors le suicide…
A. L. : Quand le monde entier s’écroule, la première réaction est de penser : “ Attends-moi, j’arrive tout de suite ”. Ce qui m’a sauvée, c’est que je n’ai pas voulu interrompre le tournage du film dans lequel je jouais, pour ne pas laisser 200 personnes sur le carreau. Dès le lendemain, je suis repartie vaille que vaille au travail, entourée de médecins. Ça a été pour moi une formidable thérapie.
P. M. : Après une telle épreuve, peut-on encore croire en la vie ?
A. L. : Mon mari m’a fait un cadeau merveilleux. En me laissant sur le bord du chemin alors que nous nous étions juré de vieillir ensemble, il m’a montré que je pouvais recommencer une nouvelle vie. Alors que je n’aurais jamais imaginé repartir de zéro à cinquante ans passés, c’est comme s’il m’avait dit : “ Tu vas leur faire voir de quoi tu es capable. Et moi, je vais t’aider ”. Et c’est vrai que, depuis son départ, je n’ai jamais eu autant d’opportunités professionnelles, d’offres émanant de la télévision et du cinéma. On dirait que de là-haut, il est devenu mon imprésario.
P. M. : Êtes-vous croyante ?
A. L. : Très. Il est inconcevable pour moi que tout s’arrête un jour. Je veux considérer que cette existence n’est peut-être, après tout, qu’une répétition générale avant la vraie réalisation, le vrai bonheur. Cela m’aide énormément à supporter toutes les épreuves de notre malheureuse existence.
P. M. : Femme fidèle et très croyante… On est loin de l’image que beaucoup de gens ont de vous…
A. L. : J’ai toujours été victime d’une sorte de schizophrénie au niveau de mon image publique. Il y avait d’un côté ce cliché de la séductrice aux tenues provocantes qui précédait mon mariage et que mes producteurs me demandaient de ne pas altérer et, de l’autre, l’Amanda follement amoureuse de son compagnon, qui vivaient une passion extraordinaire avec un garçon merveilleux. Cette situation a souvent nui à ma vie privée, qui était des plus tranquilles, avec mon mari et mes animaux, à la campagne. Mon époux a rapidement compris qu’il valait mieux se montrer le moins possible avec moi dans les soirées, pour préserver cette image de charmeuse sempiternellement accrochée au bras d’un play-boy. Il en a souffert énormément.
P. M. : Vous regrettez aujourd’hui d’avoir sacrifié votre vie privée à votre carrière ?
A. L. : Madame de Staël disait que la gloire pour une femme est le deuil éclatant de sa vie privée. J’ai souffert de ne pas avoir de véritable famille, de vie privée ni d’enfant. Ce métier est incompatible avec tout ça. Moi, je n’aurais pas supporté de voir ma mère se tortiller à la télévision en arborant des faux-cils. Une maman, c’est quelqu’un qui va chercher ses gosses à la sortie de l’école et qui les aide à faire leurs devoirs le soir. Si l’on n’est pas en mesure de renoncer à sa carrière pour ça, mieux vaut ne pas fonder de famille.
P. M. : Si c’était à refaire, vous choisiriez donc une vie loin des projecteurs ?
A. L. : Je ne ferais sûrement pas de spectacle. Pour faire ce métier, il faut être un monstre d’égoïsme, ne penser qu’à soi, ne vivre que pour son image. Les artistes ont un immense besoin d’amour mais ils ne savent pas aimer. Ils ne savent pas davantage se laisser aimer, ils sont trop paranoïaques pour cela.
P. M. : Cette course-poursuite entre plateaux de télévision, studios d’enregistrement et soirées, est-ce une fuite en avant ?
A. L. : C’est une course après le bonheur. Comme dans le poème de Paul Fort – “ Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, il va filer ” –, j’ai bien trop peur qu’il me glisse entre les doigts. Et puis, un esprit angoissé comme le mien a besoin d’être sans cesse occupé. Je suis condamnée à me saouler, à m’enivrer d’activités. Dès que je ne fais plus rien, je commence à m’ennuyer, à me regarder le nombril. C’est le début de l’autodestruction, d’une conduite d’échec. Se noyer dans le travail et la discipline, c’est ne plus avoir le temps de penser.
P. M. : Dans quels moments vous sentez-vous vraiment heureuse aujourd’hui ?
A. L. : Lorsque le garçon que j’aime me dit que je suis la plus belle du monde, qu’il est amoureux de moi et que nous serons toujours ensemble. C’est-à-dire quand je baigne dans un parfait tissu de mensonge, une pure illusion ! Le bonheur est constitué de moments éphémères qu’on vole à droite et à gauche et qui, mis bout à bout, doivent au mieux former quelques jours dans toute une vie. Ces moments très rares, je les chéris.
P. M. : Le temps qui passe vous fait peur ?
A. L. : Le corps humain est à mes yeux la perfection même, c’est une Rolls-Royce qui devrait en principe ne jamais tomber en panne. J’ai tendance à considérer la vieillesse comme une maladie, dont on viendra à bout un jour. Je n’accepte pas le déclin physique avec la sérénité de toutes mes copines qui la considèrent comme inéluctable.
P. M. : D’où votre attraction pour les hommes plus jeunes ?
A. L. : Je ne supporte pas l’idée d’un corps qui se dégrade. Les garçons avec qui je sors sont tous très beaux, jeunes et sportifs car j’aime qu’on s’entretienne. Pour moi, le physique est primordial. Dès l’école des Beaux-Arts, mon premier émoi érotique fut la statuaire antique et les sculptures de Rodin. La statue, c’est la perfection immuable : elle est lisse, ne vieillit pas… Les jeunes gens que je fréquente se rapprochent de cette symbolique. Entre nous, il y a cette considération mutuelle pour ceux qui savent respecter leur corps. S’ils acceptent de sortir avec quelqu’un qui fait le double de leur âge, c’est qu’ils admirent le fait que je ne me laisse pas aller.
P. M. : C’est aussi l’attrait d’une certaine fraîcheur d’esprit par rapport à des hommes mûrs ?
A. L. : Ils ont en effet un enthousiasme et une ingénuité que j’apprécie énormément. Comme tous les jeunes, ils font des erreurs, des bêtises. Il faut les conseiller, venir à leur secours quand ils ont des problèmes. Ce sentiment de servir à quelque chose m’est primordial. N’étant plus mariée, n’ayant pas de famille, je me sens parfois totalement inutile. Comme une cerise qu’on met sur un gâteau pour faire joli. Ces émissions où l’on m’invite pour mon charme et mon humour, elles pourraient tout aussi bien avoir lieu de la même manière sans moi. Ce sentiment d’inutilité me pèse énormément.
P. M. : Quand êtes-vous véritablement vous-même ?
A. L. : Peut-être jamais… Un masque cache l’autre, nous en avons probablement des dizaines de superposés, comme autant de facettes d’un même diamant. Dans cette interview-même, il se peut que je ne projette pas une image totalement véridique. On dissimule beaucoup de choses par pudeur ou refus d’affronter la réalité : sa fragilité, ses insuffisances, ses pulsions les moins avouables, ses contradictions… Une véritable actrice joue la comédie jusqu’au bout, y compris face à elle-même. Je me raconte des histoires, je refuse souvent de regarder la vérité en face, par crainte de sa laideur. Je l’embellis en permanence, à l’image de ma chambre que j’ai agrémentée de rideaux couleur abricot, pour qu’au réveil, lorsque le soleil les transperce, ils diffusent un teint doré qui me fera paraître plus belle à mon compagnon.
P. M. : Vous ne vous accommoderez donc jamais de la réalité ?
A. L. : J’essaie de voir le monde avec des lunettes roses. Comme Dali. Je me souviens qu’il avait l’habitude de porter des verres horriblement sales. Le jour où j’ai entrepris de les lui nettoyer, il fut épouvanté. Il se retrouvait soudain confronté à la crudité de la réalité, dans ce qu’elle a de plus implacable. Celle qu’il imaginait au loin, dans une vision vaporeuse, digne d’une odalisque, lui apparaissait soudain telle qu’en elle-même : une femme de ménage ! Au bout du compte, la réalité, il préférait la regarder au travers du filtre brumeux, du flou artstique de ses lunettes maculées…
> Lire d'autres interviews