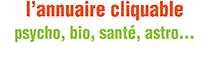Jane Birkin
En quête d’absolu
|

Rideaux épais, tapis persans, murs habillés de photos. L’appartement de Jane Birkin est tel qu’on l’imagine : confortable et fouillis. La lumière ne s’y risque qu’à tâtons, comme pour ne pas troubler cet univers chaleureux et encombré de souvenirs. C’est que la chanteuse préfère à l’éclat du jour le feu des projecteurs. À peine achevé un tour du monde triomphal de près de deux ans avec son spectacle “ Arabesque ”, qui revisite les chansons de Gainsbourg sur les envoûtantes orchestrations orientales du groupe kabyle Djam & Fam, la voici qui sort “ Rendez-vous ”* : un magnifique album de duos où elle chante en quatre langues aux côtés d’artistes aussi différents que Souchon, Daho, Chamfort, Bryan Ferry, Paolo Conte ou Caetano Veloso. Tous ces bonheurs ne suffisent pourtant pas à assurer sa sérénité. Ils inquiètent même parfois cette artiste en proie aux doutes, qui trouve dans le sommeil une perfection déculpabilisatrice.
Psychanalyse Magazine : Vous venez de parcourir le monde avec “ Arabesques ”. Que retirez-vous de ces deux années de tournée internationale ?
Jane Birkin : Par sa beauté orientale, ce spectacle fait disparaître les frontières de toutes sortes. Nous avons été ovationnés debout, en pleine guerre d’Irak, à Covent Garden et à New York. Nous avons chanté au Moyen-Orient, à Tel-Aviv comme à Ramallah. À Gaza, les enfants se précipitaient vers nous pour nous remercier d’être venus chez eux. Pendant une heure et demie, on les a emmenés sur un tapis volant bien loin de là. Montrer par la musique et par le chant de quelle culture on est issu, d’où l’on vient, c’est une grande fierté. C’est aussi par l’art qu’on peut faire changer le regard de l’autre.
P. M. : L’engagement a toujours marqué votre parcours. On vous voit souvent aux côtés d’organisations comme Amnesty International et la Ligue des Droits de l’Homme…
J. B. : J’ai eu la chance d’avoir un père très impliqué dans les questions sociales et humanitaires. Petite, je marchais déjà avec lui contre la peine de mort. Quand je suis arrivée en France, j’ai continué. J’ai défilé tout de suite avec Badinter, le Grand Rabbin de France et les représentants de toutes les religions, au moment du procès de Patrick Henry. Les gens nous jetaient des objets par la fenêtre, c’était l’une des choses les plus impopulaires à l’époque. J’ai aussi adressé une lettre à France-Soir, le journal préféré de Serge, pour féliciter les jurés de Troyes de n’avoir pas prononcé la peine capitale. Serge avait peur pour moi : “ Comment ? Tu arrives dans un pays et tu te mets immédiatement à manifester ? ” En tant que fils d’immigrant juif venant de Russie, il ne voulait surtout pas faire de vagues. Pour moi, ce n’était qu’un début. Le trajet Père-Lachaise-République, depuis, je connais par cœur !
P. M. : On vous perçoit comme quelqu’un d’extraordinairement exigeant avec vous-même. L’êtes-vous autant envers autrui ? Quels défauts ne pardonnez-vous pas chez l’autre ?
J. B. : Je prends les gens avec leurs défauts et leurs qualités. Je pense avoir plutôt fait preuve d’indulgence avec les gens que j’ai aimés et qui ont traversé mon chemin. J’ai tenté de comprendre à travers leur parcours les raisons de leurs actions et de leurs attitudes. La seule chose que je n’accepte pas, c’est quand les gens blessent consciemment les autres. Mais sinon, je pense qu’on doit aimer les individus en bloc, avec cette espérance qu’ils vous aimeront en bloc eux aussi, peut-être. C’est d’ailleurs peut-être pour cela qu’on choisit de les aimer comme ça.
P. M. : Vous paraissez vous interroger beaucoup sur vous-même. Avez-vous tenté l’expérience de la psychanalyse ?
J. B. : Une fois, à cause d’un de mes enfants. Je souhaitais faire une sorte de thérapie familiale à trois, avec son père. Mais je suis la seule qui se soit pointée au rendez-vous ! J’allais repartir mais j’étais dans un tel état que la dame m’a demandé très gentiment pourquoi je ne restais pas pour moi-même. Je lui ai dit que je ne pouvais pas dépenser de l’argent sur moi. Je ne sais pas pourquoi, j’avais une sorte de blocage à parler de moi pendant une heure, alors que j’ai déjà un métier où l’on s’exprime pas mal. Je pensais que je n’en avais pas le droit. Finalement, elle m’a gardée et je l’ai vue trois fois de suite. Elle était formidable. Elle m’a apporté des réponses sur ce qu’il fallait faire ou ne pas faire pour apaiser mon désordre mental.
P. M. : Que vous a-t-elle appris au juste ?
J. B. : Mon problème, c’est que j’essaie de faire trop de choses, en pensant que je décevrais les gens si je n’y arrivais pas. Cette dame m’a aidée à accepter l’idée que je devais poser des limites à tout cela. Qu’il fallait prendre chaque jour l’un après l’autre, survivre au jour le jour. Que j’avais le droit de garder du temps pour moi. Je ne peux pas vous dire la libération que cela a été. Puis, il m’est arrivé un pépin et j’ai dû interrompre ces séances avec elle. Mais cette expérience d’introspection m’a plu et je sais que cela a sauvé littéralement beaucoup de personnes autour de moi. L’écoute d’une personne étrangère qui n’est pas liée à votre vie est essentielle. Cette écoute extérieure, elle vous calme, car elle n’est pas impliquée dans votre désordre intérieur. Quand, par exemple, on parle de ses propres enfants, on ne peut s’empêcher de se justifier inconsciemment, alors que c’est l’enfant, et non plus vous-même, qui devrait se retrouver au centre du tableau.
P. M. : Cultivez-vous un certain sentiment de culpabilité ?
J. B. : J’ai les souvenirs aussi sélectifs qu’une machine à laver, comme dit la chanson. C’est épouvantable de décider de ne garder que les blessures. Je ne sais pas pourquoi cela m’arrange de ne conserver que les reproches alors que j’ai reçu plein de compliments. C’est sûrement un désir de se sentir en situation d’injustice. Pourquoi faut-il que je me punisse tant ?
P. M. : À tel point que vous dites préférer chanter dans la souffrance que dans le bonheur, comme si vous craigniez qu’à une joie succède inéluctablement un brusque retour de balancier…
J. B. : Chaque fois que je me suis surprise à éprouver une petite satisfaction après être par exemple arrivée à toucher la note juste un soir, l’instant d’après, je me suis trompée dans les paroles ou j’ai eu un blanc. Le contentement est toujours de courte durée. C’est la même chose quand je joue au théâtre. Michel Piccoli avait l’habitude de me taquiner en me demandant chaque soir : “ Alors, contente ? ” car il savait que je n’osais pas l’être ! Je pensais que si la représentation s’était déroulée sans problème ce soir-là, et que si j’en éprouvais la moindre satisfaction intérieure, un problème surviendrait le soir suivant. Donc, comme partenaire, je suis vraiment suante ! Je crains les applaudissements par peur du lendemain. Ne pas pouvoir prendre de plaisir sur le moment, c’est effrayant, je me punis. D’ailleurs, je pourrais devenir religieuse du jour au lendemain. Cela ne me coûterait rien du tout. Au contraire. Depuis sept mois, je n’ai pas fumé une seule cigarette, pas bu une goutte de vin. C’est comme si j’étais rentrée au couvent. Je laisse les autres autour de moi faire à leur guise : boire, fumer, faire l’amour… Ils peuvent bien faire ce qu’ils désirent car, moi, je tiens la forteresse : je sais que si je ne fais rien qui me donne satisfaction, rien ne nous arrivera. Ou peut-être est-ce encore plus pervers que cela ? C’est plutôt que je penserais que c’est ma faute si la moindre chose arrivait après que j’ai pris une clope, fumé une cigarette ou embrassé quelqu’un. J’ai trop peur de me sentir coupable, alors, c’est plus simple de me conduire ainsi !
P. M. : Cette culpabilité est-elle la raison des insomnies qui vous assaillent constamment ?
J. B. : Ma mère m’en a peut-être donné les clés. Je suis née à sept mois seulement. En décembre 1946, juste après la guerre, ce n’était pas rien. Les incubateurs n’existaient pas. Alors, on m’a mise dans une boîte à chaussures sur un radiateur avec un linge humide sur moi. Je n’avais ni cils ni cheveux, un vrai œuf à la coque ! Comme j’étais un bébé vulnérable, un peu monstrueux et peut-être rigolarde, je pense que les infirmières de garde ont eu envie de m’amuser toutes les nuits. Du coup, la journée, je tombais de sommeil. Et quand mes parents m’ont ramenée chez eux, je braillais toute la nuit. À tel point qu’ils ont été obligés de déménager, pour ne pas gêner les voisins. Ils m’ont emmenée chez le médecin de famille qui a conseillé de mettre du whisky dans mon biberon ! En désespoir de cause, ils ont même été voir les docteurs les plus fameux d’Harling Street, qui leur ont conseillé de me donner des somnifères. Mon horloge était complètement détraquée.
P. M. : C’est toujours le cas aujourd’hui ?
J. B. : Je suis quelqu’un de la nuit, comme il y a des gens de jour. Le matin, je ne vaux rien. Jacques Doillon me disait que je perdais un an chaque heure qui passait dans la journée. Et c’est vrai. Le matin, je me réveille toute bouffie, mais vers vingt heures, quand je rentre sur scène, je suis devenue plus mignonne. La manière dont je mène mon métier à l’heure actuelle me convient donc parfaitement. Par contre, je plains les actrices qui, comme mes filles, doivent se lever à six heures du matin pour jouer et embrasser leur partenaire ! Moi, à quatre heures du matin, je ne dors toujours pas.
P. M. : Que faites-vous alors ?
J. B. : Je m’assomme. Je me donne ce privilège de me mettre hors d’état de nuire, pour ne plus emmerder le monde. Ne plus cogiter. Surtout, ne plus réfléchir, cesser de me demander si j’ai bien fait de faire telle chose, si je n’aurais pas dû faire ceci au lieu de cela… Sans parler de toutes les autres pensées qui peuvent revenir la nuit. Je me souviens des nuits passées seule avec Dora (ndlr : son bulldog) dans notre ancien appartement, à rôder à quatre heures du matin dans les escaliers, solitaire, où je ne changeais même plus les ampoules. C’était devenu terrifiant, une vraie maison Husher. Alors je mets les boules Quiès, je prends des somnifères et je me mets K.O.. Dormir, c’est peut-être le moment que j’aime le plus.
P. M. : Même si le sommeil, c’est l’absence de conscience, une “ petite mort ” ?
J. B. : La mort ne me fait pas peur. Je me dis : quel soulagement ! Cela va être comme pendant le sommeil, je ne vais être coupable de rien. Même peut-être dans les souvenirs des autres, mes erreurs seraient un peu gommées car, quand on meurt, on se retrouve rehaussé d’un petit cran. Les gens oublient les mauvais souvenirs qu’ils avaient de vous, ils ne gardent que la part la plus plaisante. Mais mourir la première, surtout. Être la dernière survivante sur le radeau, imagine l’horreur ! Oui, dormir, c’est une petite mort, mais moi j’aime ça, ça m’évite d’errer, de gamberger, d’être hors de contrôle. Pendant qu’on dort, on ne boit pas, on ne fume pas… Une façon définitive de ne pas faire d’excès. C’est une dépendance comme une autre. Je ne suis pas guérie…
*Rendez-vous – Capitol Music
> Lire d'autres interviews