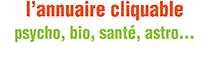L'autoanalyse de Judith Godrèche
|

Psychanalyse Magazine : On vous sait très intéressée par les discours psychanalytiques. Dans votre cas précis, la psychanalyse a même, semble-t-il, pris une part importante dans votre construction psychique d'enfant...
Judith Godrèche : Oui, elle est intervenue dans mon enfance à la fois comme une fascination et comme un rejet. Mon père est psychanalyste et, petite fille, je l'ai toujours vu exercer à la maison, disparaissant derrière une porte pour recevoir ses analysants. C'était une atmosphère mystérieuse et un peu terrorisante car j'avais, à l'époque, une image négative des gens qui étaient en analyse. Parfois, c'était moi qui leur ouvrais la porte et je fantasmais sur des pathologies féminines de folie ou d'hystérie absolument terrifiantes. Mon père avait ce souci de discrétion qui voulait qu'il ne me parle jamais du cas et des souffrances de ces femmes qu'il recevait (car dans mon souvenir, il y avait une majorité de femmes) et donc mon imaginaire était entièrement libre.
P. M. : Aviez-vous peur pour lui qui côtoyait cette “ folie ” ?
J. G. : Bien sûr. Son métier le mettait aux prises avec une réalité qui m'angoissait parfois. Un jour, j'étais seule à la maison et j'ai ouvert la porte à l'une de ses patientes qui voulait absolument le voir en dehors des heures de consultation. Ces histoires de transferts négatifs, je les comprends aujourd'hui mais elles m'effrayaient un peu à l'époque. En même temps, je comprenais déjà les ressorts de séduction et de fascination de la psychanalyse et parfois du psychanalyste. Pour moi qui ai eu une relation très forte et très fusionnelle avec mon père, ce métier le rendait peut-être encore plus fascinant car il a toujours été sensible et à l'écoute de ce qui naissait en moi quand j'étais petite fille, ce qui semblait rare quand j'écoutais les récits de père absent de mes copines. Mon père et ma mère (qui est psychologue) étaient animés du même respect de mon intégrité et de ma personnalité mais ils ont néanmoins tenu, de manière subtile, à m'ouvrir des portes sur leur monde en me rendant accessibles la musique, le cinéma, la comédie. C'est ce qui m'a donné, je crois, une certaine force ou une foi dans ce que je pouvais faire.
P. M. : Cette ambivalence vis-à-vis de la psychanalyse a-t-elle rendu difficile la démarche de votre première consultation ?
J. G. : Je suis partie de chez moi à quinze ans ; après, j'ai vécu avec quelqu'un (le réalisateur Benoît Jacquot) dont je me suis séparée à dix-neuf ans. Je me sentais bloquée. Impossible de trouver la force en moi ou autour de moi pour me sortir de cette situation affective très douloureuse. Quand mon père m'a suggéré de rencontrer un analyste, je l'ai très mal reçu ; j'avais l'impression qu'il me jugeait folle comme celles que j'avais imaginées dans son cabinet des années auparavant. Finalement, j'allais tellement mal que j'y suis allée et j'ai ainsi enclenché une nouvelle étape de ma vie.
P. M. : Vous avez déclaré : “ Je n'envisage pas de partager la vie d'un homme qui ne suive ou n'ait suivi une analyse ”. Vous qui semblez y trouver une clé pour vivre à deux, avez-vous fait du prosélytisme auprès de Dany Boon, votre compagnon ?
J. G. : Je pense que toute personne devrait un jour passer par là. Alors bien sûr, je sais qu'il subsiste beaucoup de clichés sur la psychanalyse et qu'il est parfois mal vu de faire du prosélytisme à ce sujet mais j'ai constaté que tous les garçons avec lesquels j'ai vécu une histoire
en auraient eu besoin (elle rit). Peut-être est-ce plus difficile pour un homme de faire cette démarche mais j'en ai fait l'expérience, ce travail se répercute aussi sur la vie de couple : les disputes sont plus constructives et puis, enfin, on s'écoute ! Pour Dany, je n'ai pas cherché à le pousser à voir un analyste ; c'est une démarche qui lui est propre, personnelle mais nous aimons bien aborder le sujet tous les deux.
P. M. : Vous évoquez souvent un “ désir d'enfant ” qui s'est manifesté très jeune. Auriez-vous pu envisager de faire un enfant uniquement pour vous ?
J. G. : J'aurais pu et je m'étonne de ma solidité de ne l'avoir jamais fait malgré tout. Je suis devenue actrice très jeune et je me suis retrouvée assez vite vivant en couple comme une adulte. J'ai d'ailleurs fait beaucoup de choix impulsifs dans ma vie amoureuse mais, malgré tout, heureusement, je n'ai pas fait d'enfant avant d'en être capable et de rencontrer celui dont je pressentais qu'il allait se découvrir comme un bon père. Je pense que j'ai un côté sain qui m'a permis d'attendre jusqu'à vingt-cinq ans.
P. M. : À vingt-cinq ans justement, vous commenciez à tourner à Hollywood après le grand succès de “ Ridicule ” (Patrice Leconte) ; or, vous avez choisi de mettre votre carrière entre parenthèses après la naissance de votre fils...
J. G. : J'étais enceinte quand je me suis mise à lire Dolto et Winnicott. J'ai pris conscience qu'il fallait que je sois là au tout début, auprès de lui, pour le soutenir et l'introduire au monde. Donc je l'ai allaité une année, ce fut une année à lui. J'ai “ sacrifié ” une année de mon travail de comédienne au moment où ma carrière démarrait aux Etats-Unis mais jamais je n'aurais pu le quitter ces premiers mois. Un tout petit enfant représente tout ce qu'on a été, il nous parle de nous et je crois aussi qu'il nous renvoie violemment à nos peurs d'enfant. Même si on connaît l'utilité des crèches, parfois je me demande si les gens ne fuient pas leurs propres faiblesses et autres fragilités en y oubliant leur enfant le temps d'une journée de travail. Nous, nous avons préféré vivre ces quelques mois en osmose totale, à trois à Los Angeles, au soleil, loin de Paris.
P. M. : Vous évoquiez la fusion en parlant de la relation à votre père mais les médias renvoient la même image fusionnelle de votre couple. Est-ce plus confortable de vivre cette curiosité médiatique à deux ?
J. G. : Je n'aime pas l'idée que l'on fasse de nous un couple objet. Nous avons travaillé ensemble sur le dernier spectacle de Dany dont j'ai assuré la mise en scène et nous nous sommes laissés convaincre de réaliser beaucoup de promotions ensemble. C'était un peu maladroit de notre part car j'ai parfois l'impression qu'on en vient à idéaliser notre couple, un peu à l'image de ce que vivent Brad Pitt et Jenifer Aniston, toutes proportions gardées bien sûr. Mais il est bien évident que si notre couple suscite autant la curiosité, c'est avant tout pour l'effet de surprise qu'il provoque. Dany est né à Armentières dans le Nord et vient d'un milieu ouvrier et moi, je suis fille de psychanalyste parisien et réputée intellectuelle. Évidemment, nous n'échappons pas au cliché de l'intellectuelle amoureuse du clown et chacun cherche à savoir ce qui se cache derrière tout ça. Comme Dany est très galant avec moi et me laisse souvent prendre la parole quand nous sommes interviewés, on pense que je l'écrase (elle sourit). En fait, depuis le début, c'est moi qui suis son rythme car je crois que de nous deux, c'est moi encore qui ai le plus besoin de stabilité et d'un cadre de vie solide.
P. M. : Vous avez débuté à quinze ans au cinéma mais n'avez-vous jamais douté de votre désir d'être actrice ?
J. G. : J'ai toujours su que j'avais une grande envie artistique. J'ai toujours écrit ; je faisais de la danse puis je suis devenue actrice et j'ai ressenti quelque chose de vital dans ces différentes façons d'expérimenter ma créativité. Donc les doutes et les questionnements ne se sont pas posés sur ce métier d'actrice qui m'avait si magnifiquement rencontré dans mes désirs d'adolescente puisque j'avais écrit avec Jacques Doillon des scènes de “ La fille de quinze ans ” et également quelques scènes de “ La Désenchantée ” avec Benoît Jacquot. Par contre, les doutes sur l'accès à la féminité, à la maternité, je les connais comme nous toutes. C'est également, pour moi, de la matière à jouer. Le costume de la femme que j'interprète vient aussi très souvent à mon secours, comme une féminité du personnage qui s'impose à moi et qui me débarrasse d'une partie de la mienne. Après la force que m'a donné mon instinct d'actrice et mon désir, je dois aller au-delà et travailler pour prouver que je suis autre chose que juste vivante.
P. M. : Pour y parvenir, seriez-vous tentée par la réalisation, comme vient de l'expérimenter Sophie Marceau pour “ Parlez-moi d'amour ”, son premier film ?
J. G. : Dans “ Parlez-moi d'amour ” (sortie prévue en septembre), j'interprète le personnage d'une femme qui s'apprête à partir, à quitter l'homme qu'elle connaît depuis ses dix-sept ans et avec qui elle a eu trois enfants. Avant de partir pour renaître, se pose la question de ce qu'elle peut faire de sa propre enfance. C'est une question que je me suis souvent posée, moi qui ai découvert le cinéma à travers les comédies musicales américaines et qui ai par la suite entretenu un rapport très fort à l'idéal. Je suis, par exemple, restée très longtemps dans l'attente d'une relation d'amour avec des mots qu'on ne se dit qu'une fois. Heureusement, sur ce point, j'ai réussi à grandir... Mais ce que vit Sophie en réalisant son premier film, j'aimerais y accéder un jour moi aussi. Pour moi, écrire et donner vie au scénario qu'on a imaginé, c'est à la fois ne pas renoncer aux histoires que l'on se racontait enfant et, en même temps, enfin devenir adulte. Pour l'instant, en tant qu'actrice, je suis dans l'abandon, totalement prise en charge par un metteur en scène qui devient un peu mon père ou ma mère au moment du tournage. Devenir réalisatrice, ce serait mûrir, me sentir vieille, tout en continuant à rêver tout haut.
> Lire d'autres interviews