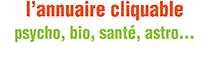Nos souvenirs de lycéens nous renvoient à cette fameuse « madeleine » de Proust, morceau d’anthologie littéraire incontournable à l’évocation de cet écrivain célèbre. Le chanteur Dave a quant à lui, dans les années 70, contribué à populariser avec sa chanson « Du côté de chez Swann » une œuvre intemporelle. Mais qui était donc Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust ? « À la recherche du temps perdu », son œuvre maîtresse, donne certes des éléments de réponse mais l’écrivain affirme qu’il s’agit simplement d’un roman, d’une fiction, même si cette invention est appelée par l’auteur la stylisation du réel, qui caractérise l’œuvre d’art…
Asthme et... bénéfices !
Lorsque Marcel Proust naît, dans le XVIème arrondissement de Paris (autrefois appelé quartier d’Auteuil) le 10 juillet 1871, ses parents craignent qu’il ne survive pas, tant il paraît fragile. Marcel est asthmatique et le restera toute sa vie. Sa mère, Jeanne, femme de grande culture et issue de la bourgeoisie parisienne, l’entoure et le surprotège. Une relation de dépendance mutuelle qu’elle entretiendra toute sa vie et dont l’adolescent, puis l’homme, ne se défera jamais réellement. Dans le fameux Questionnaire de Proust qui fera plus tard des émules, le futur écrivain note que son plus grand malheur serait d’être séparé de sa mère. Quant à son père, Adrien, il est ce que l’on appelle aujourd’hui un self made man. Issu d’une famille plutôt modeste, il devient professeur agrégé de médecine, puis conseiller du gouvernement en matière d’épidémies. Le jeune Marcel, de santé précaire, bénéficie donc d’une quasi adoration parentale. Bien que souvent absent, il est inscrit au lycée Condorcet et se révèle d’une intelligence supérieure. Il se passionne notamment pour la littérature. Victor Hugo, Alfred de Musset, n’ont aucun secret pour lui et il connaît leurs œuvres par cœur. Le jeudi, il joue dans les jardins des Champs Élysées avec Antoinette et Lucie Faure, filles du futur Président de la République. Pendant ces années sans soucis - hormis ses graves crises d’asthme -, ses amis se nomment Jacques Bizet, Fernand Gregh et surtout Daniel Halévy avec qui il écrit dans la revue littéraire du lycée.
Une vie mondaine
Ses études secondaires achevées, Marcel Proust effectue son service militaire à Orléans. Puis il rentre à la Sorbonne et devient licencié ès lettres en mars 1895. N’ayant aucune difficulté financière, le futur écrivain fréquente assidûment les salons artistiques mondains et les endroits élégants au point que circule à son propos l’appellation : le « Proust du Ritz » ! Il écrit quelques chroniques pour la presse mais il puise, surtout dans ce milieu élitiste, la substance de son inspiration quant aux personnages de romans qui prendront forme dans la deuxième partie de sa vie. Ainsi, le très snob Charles Haas sera son modèle lorsqu’il imaginera la figure de Charles Swann dans le premier volume d’« À la recherche du temps perdu », Madame André Maurois devenant la duchesse de Saint-Loup, petite-fille de son héros. On parle beaucoup de ce jeune homme singulier qui attire par sa physionomie. Son regard est fascinant, témoigne le Marquis de Lauris, son visage très pâle contraste avec la noirceur de sa chevelure. Mais c’est surtout par sa façon unique de s’adapter à toutes les conversations et de s’intéresser à son interlocuteur que Marcel Proust séduit. Aux dires de tous ceux qui le côtoient, même si le mot snobisme revient souvent, personne n’est indifférent au mystérieux magnétisme qui émane de lui. Bien qu’il ait déjà publié « Les Plaisirs et les jours » (1896) et traduit « la Bible d’Amiens » de John Ruskin (1904), il est à cette époque-là quasiment inconnu en tant qu’écrivain.
Sous une frivolité apparente, tout en continuant à s’intéresser aux gens du monde et à les recevoir chez lui, Marcel Proust aiguise son regard, élaborant l’œuvre qui le rendra célèbre pour la postérité. Il se montre passionné par la filiation des grandes familles. Il écrit en secret les premières pages d’un livre dont le style inaugure le roman moderne, cherchant à sonder l’âme plutôt qu’à raconter une intrigue. Il se lance en fait dans l’exploration de son propre psychisme. Lorsqu’il se rend sur les plages à la mode, séjournant au Grand Hôtel de Cabourg, il passe des heures simplement à observer les gens, même les grooms. Son ouvrage futur, « À l’ombre des jeunes filles en fleur » (1918), est imprégné de ces périodes de solitude contemplative qui le renvoient sans cesse à son passé. Il se plaît également en la compagnie d’artistes tels Renoir, Rodin et Jean Cocteau qu’il reçoit souvent le soir au 102 Boulevard Haussmann.
Maladie, persévérance et sublimation
En 1903, Marcel Proust perd son père, puis deux ans plus tard sa mère. Il s’agit d’un moment crucial pour l’homme et l’écrivain. Sa santé déjà très fragile se détériore peu à peu. N’avait-il pas dit des années auparavant que la séparation d’avec sa mère serait une véritable déchirure ? À partir de 1907, il engage comme chauffeur Alfred Agostinelli qui devient son secrétaire en 1912. C’est l’être que j’ai le plus aimé après ma mère, confie Proust lorsqu’Alfred meurt dans un accident d’avion en mai 1914. Proust est homosexuel et un des premiers romanciers européens à traiter ouvertement de ce sujet. C’est à partir de l’âge de 40 ans que Marcel se retire peu à peu du monde et entame un fabuleux travail d’écriture. Marcel Proust sait qu’il est destiné à devenir un grand écrivain. Désormais, il va vivre essentiellement pour son œuvre. Porte fermée, Proust travaille d’arrache-pied. Plus de deux-cents personnages se mettent à exister sous sa plume. Il corrige, retranche, ajoute des pages collées que sa fidèle gouvernante Céleste Albaret, après la mort d’Alfred, a la charge de remettre en forme. La particularité du style de Proust réside en des phrases extrêmement longues, comme s’il voulait maîtriser le temps. Phrases qui contrastent avec ses crises d’asthme lorsque son souffle devient court et lui fait craindre la mort à tout moment ! Proust parle comme il écrit : Des phrases pleines d’arborescences qui ressemblent à des chemins de montagnes qu’on gravissait sans jamais arriver au sommet, commente Paul Morand, diplomate attaché au cabinet d’Aristide Briand, auprès de qui il s’enquiert du déroulement de la guerre à laquelle il ne peut participer à cause de son état de santé. Contraste saisissant chez cet homme se traînant de son lit au bureau mais capable d’une puissance de travail phénoménale ! Tout son être - y compris son symptôme - est désormais mis au service d’une œuvre introspective qu’il veut aussi philosophique. Pour Proust, l’amour et l’amitié n’existent pas. L’Homme est fondamentalement seul et doit l’accepter. Il s’agit d’une telle certitude pour lui qu’il ne supporte pas que son ami, l’écrivain Emmanuel Berl, nouvellement fiancé, le contredise. Après des heures de discussion, à bout d’arguments, Marcel Proust lui jette ses pantoufles à la figure et le chasse en lui disant qu’il est « bête » !
La comédie… humaine
On me lira, oui, le monde entier me lira…, assure Marcel Proust à Céleste. Il ne doute jamais de l’authenticité de sa mission littéraire. Il reçoit d’ailleurs en 1919 le prix Goncourt pour le deuxième volet de sa saga. Le monde de la littérature, en la personne de l’éditeur Jacques Rivière, directeur de la Nouvelle Revue Française, consacre l’écrivain et l’édite. Proust est aujourd’hui traduit dans le monde entier. Jusqu’à son dernier souffle, le 18 novembre 1922, l’écrivain aura rempli plus de 3 000 pages. Dans la nuit qui précède sa mort, il appose le mot « fin » à son dernier ouvrage, « Le temps retrouvé », et se dit enfin soulagé, tant l’angoisse le taraudait nuit et jour à l’idée de ne pas parvenir à achever son œuvre. À la fin des années 50, celle-ci est reconnue universellement. D’un roman à l’autre, le lecteur assiste à l’évolution sur quatre générations, de 1840 à 1918, d’une comédie humaine dont la longueur n’a rien à envier aux Rougon-Macquart de Zola et aux écrits de Balzac. On y découvre, à travers le prisme du narrateur, un tableau sans concession des relations humaines mais surtout, et c’est ce qui en fait la singularité, l’expression d’une sensibilité à fleur de peau rarement égalée jusqu’ici. « À la recherche du temps perdu » restitue la quête psychologique de chaque être humain qu’il met en scène : cette incontournable opposition entre le présent et le passé que chacun investit comme il le désire mais que seule l’œuvre d’art, selon Proust, détachée des contingences limitées de l’incarnation, peut transcender.
Jean Roudier